Haley Smith : « Ma relation avec la maladie mentale est toujours active »
Je suis très habituée à parler de mon expérience de la maladie mentale au passé.
En fait, j’ai parlé de mon histoire assez souvent pour qu’elle se soit transformée en une anecdote soignée, presque banale comprenant un début, un milieu et une fin satisfaisante : j’ai développé une maladie, j’en ai souffert pendant un certain temps, puis j’ai acquis les outils et le soutien nécessaires pour m’en remettre et me maintenir.
Bien sûr, cette version est tellement simplifiée qu’elle frôle le mensonge. Cependant depuis 10 ans, c’est la voie que j’ai empruntée; les moments les plus sombres de ma maladie étaient des souvenirs plutôt flous et le processus que j’avais mis en place pour me rétablir et me gérer au quotidien était adéquat quand venait le temps de surmonter les creux de vague occasionnels.
Puis, la COVID-19 est apparue. De mars à octobre 2020, j’ai atteint un creux que je n’avais pas connu depuis l’âge de 14 ans.

Dès mon plus jeune âge, j’ai montré des tendances perfectionnistes et anxieuses importantes. J’étais très compétitive, j’avais tendance à m’inquiéter et j’avais un besoin absolu de tout faire parfaitement. J’avais aussi très peur : peur de décevoir les personnes en position d’autorité, peur d’échouer et peur d’un tas de choses que je n’arrivais pas à nommer ou définir à un si jeune âge. Avec le recul, je sais maintenant que mes peurs étaient existentielles. J’avais peur de la mortalité, d’une vie sans signification, et je n’avais pas la maturité requise pour affronter ces choses.
Ces peurs, ajoutées à mes tendances anxieuses, représentaient un combo néfaste. Au cours de mes années de pré-ado, je suis devenue progressivement de plus en plus anxieuse face à de plus en plus de choses: d’abord les études, ensuite les performances sportives, puis les situations sociales. Une fois à l’école secondaire, l’anxiété était devenue accablante, particulièrement marquée dans quelques domaines clés : la santé, les performances physiques et la nourriture.
Au cours de la neuvième année, j’ai développé un trouble alimentaire qui risquait de me tuer.
J’ai arrêté de dormir, j’ai perdu plus de 20 livres et j’ai développé de nombreux effets secondaires physiques au moment où mon corps commençait à me lâcher. En juin de cette année-là, j’étais à risque d’insuffisance cardiaque et j’ai été admise à l’hôpital avec une date de sortie indéterminée. J’ai été confinée à un alitement strict pendant les cinq premières semaines de mon séjour à l’hôpital, j’ai été soumise à d’innombrables tests physiques et traitements psychologiques, et j’ai été complètement coupée du monde extérieur.
Deux mois plus tard, j’ai obtenu mon congé de l’hôpital à la condition que je poursuive la thérapie, que je participe à des réunions au département de nutrition de l’hôpital et que je me soumette à des pesées hebdomadaires sans préavis, et supervisées par un médecin, pour vérifier si je mangeais. Apprendre à vivre tout en maîtrisant une anxiété paralysante et un trouble alimentaire représentait tout un défi, c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant, j’ai réussi à le faire.
Au cours de la décennie qui a suivi, j’ai appris à pratiquer le yoga, à méditer et à utiliser le concept de l’autocompassion. J’en ai appris sur le pouvoir de ma respiration et comment elle pouvait m’aider à traverser les périodes de détresse existentielle. J’étais entourée de personnes (famille, amis, enseignants, entraîneurs et professionnels de la santé) qui ne m’ont jamais abandonnée. Peut-être plus important encore, j’ai trouvé un but dans la vie : maîtriser l’art du vélo de montagne et, peut-être, participer un jour aux Jeux olympiques.
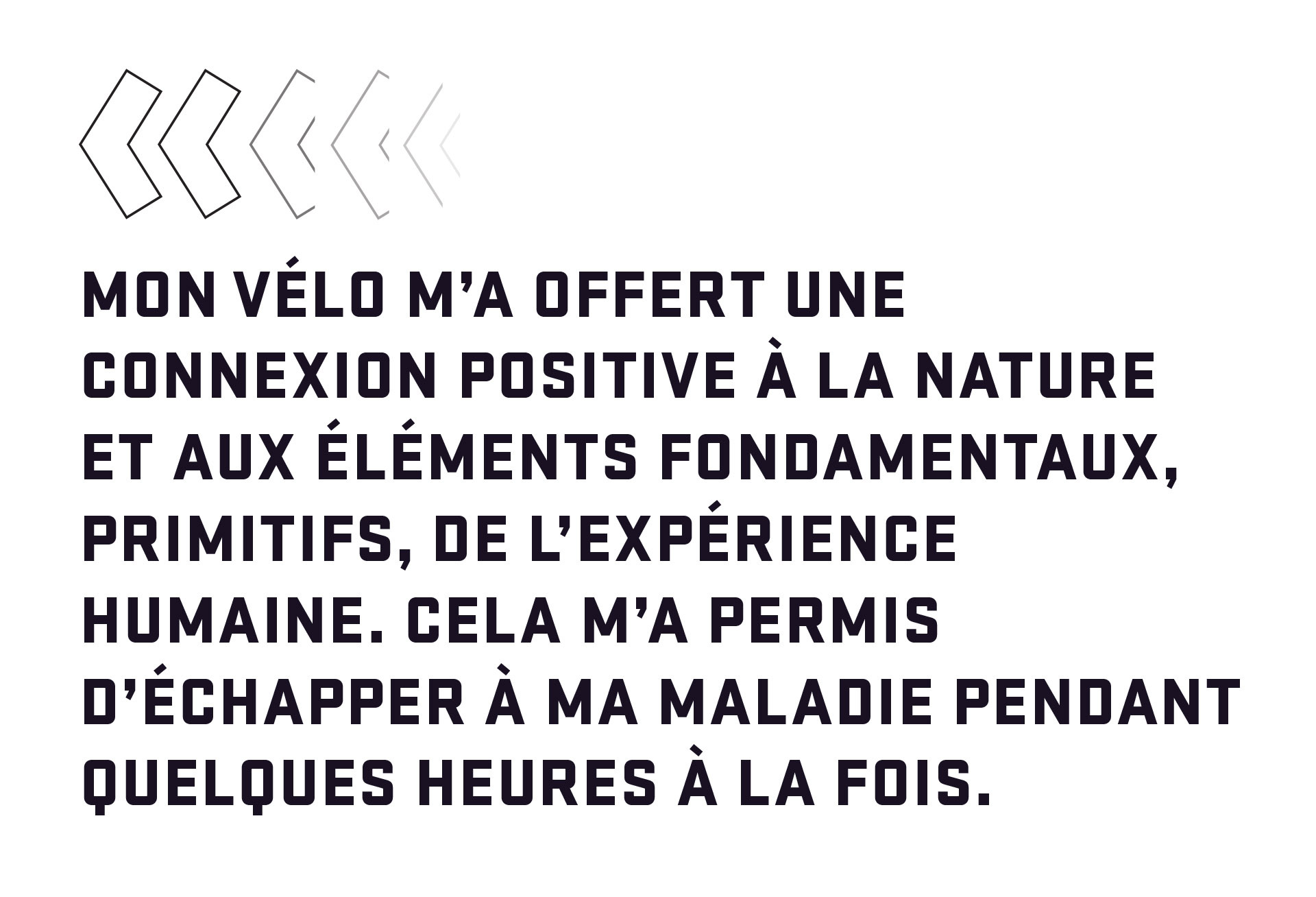
Dès le jour où j’ai quitté l’hôpital, le vélo est devenu une bouée de sauvetage. En fait, j’avais passé ces mois à l’hôpital à rêver de m’initier au sport que mon père et mon frère adoraient tant. J’ai passé des heures à feuilleter des magazines et à rechercher le vélo que j’achèterais. Cet automne-là, quelques semaines après ma sortie, j’étais la fière propriétaire de mon tout premier vélo de montagne.
Jusque-là, la plupart des activités sportives avaient été relativement faciles pour moi. Mais pas le vélo de montagne. J’ai toujours été douée dans l’art du travail acharné, L’endurance physique requise n’était donc pas un obstacle important. Mais l’aspect technique? C’est une autre paire de manches. Pendant les premiers mois (peut-être même les premières années) de mon parcours en vélo de montagne, je revenais inévitablement de chaque balade à vélo couverte de sang et de bleus.
Vous vous demandez pourquoi j’ai persévéré? La réponse courte est que je suis incroyablement têtue. La réponse plus longue est que rien ne m’avait jamais mise au défi et accrochée autant que le vélo de montagne. J’étais accro à la courbe d’amélioration, à la concentration nécessaire et à l’importance d’être dans le moment présent pour réussir à parcourir les sentiers hors-piste. Et sur le plan spirituel, mon vélo m’a procuré un lien positif avec la nature et les éléments fondamentaux et primitifs de l’expérience humaine. En d’autres termes, il m’a permis d’échapper à ma maladie quelques heures à la fois.
Au début, je ne participais pas à des courses, mais j’ai finalement pris part à des événements locaux. Puis, à des compétitions provinciales, nationales et, enfin, internationales. J’ai été nommée à l’équipe des championnats du monde pour la première fois à 17 ans, participant à la course de cross-country chez les juniors. J’ai vu ma compatriote Catharine Pendrel remporter son premier titre mondial. Cette expérience a allumé une flamme en moi. À partir de ce moment, j’ai voulu savoir jusqu’où pourrait me mener ce sport, à rêver que je pourrais peut-être, un jour, aller aux Jeux olympiques.
Pendant que mes rêves devenaient plus ambitieux, je continuais à prendre du mieux et de la maturité sur le plan psychologique. J’ai développé une meilleure conscience de moi et de meilleures stratégies d’adaptation. À la fin de mes études universitaires, dans la catégorie des moins de 23 ans, je me sentais à l’aise de dire que je n’avais plus de trouble alimentaire. La plupart du temps, mon anxiété était maîtrisée. J’ai commencé à parler publiquement de mon expérience dans les écoles, les clubs et les organisations et les éléments sociaux de ma mission sportive ont commencé à prendre forme.
Depuis cinq ans, mon rêve est de participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Tout ce que je fais s’inscrit dans la poursuite de cet objectif. Ces dernières années, ma motivation n’est plus uniquement l’amélioration personnelle, mais aussi le désir d’avoir un impact dans la vie des jeunes athlètes. Je veux prouver qu’un diagnostic de trouble alimentaire n’est pas une condamnation à perpétuité, je veux améliorer la littératie sociale de la santé et de la maladie mentales et aider d’autres jeunes femmes à surmonter ces défis au niveau individuel.
Jusqu’en mars 2020, tout allait très bien. J’avais pratiquement mérité une place au sein de l’équipe olympique grâce à une médaille de bronze sur le circuit de la Coupe du monde en 2019, et même si j’avais frôlé les limites de ma santé mentale dans cette poursuite, j’étais sur le point d’atteindre mon objectif ultime.
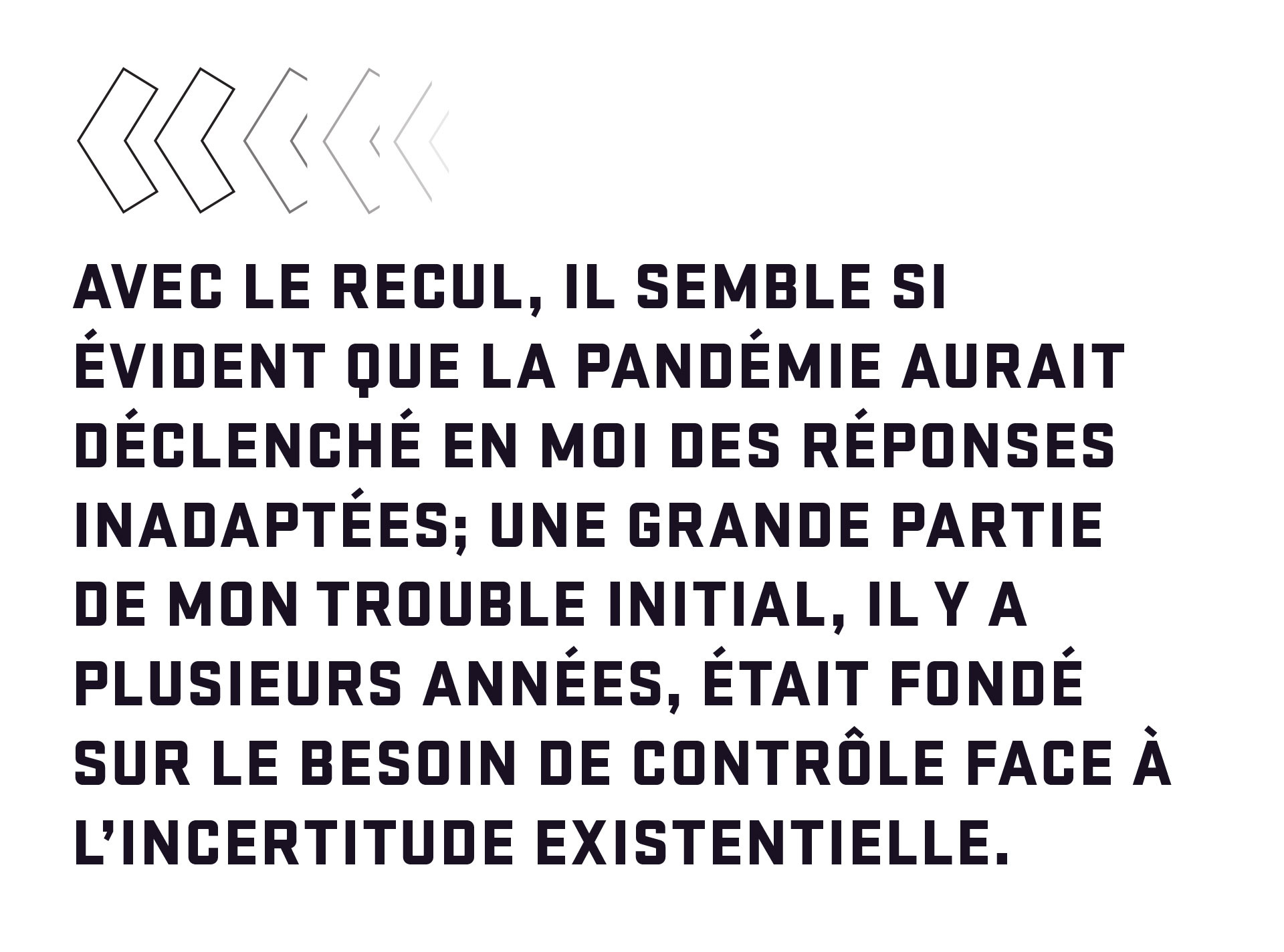
Au début, je ne me sentais pas vraiment touchée par la pandémie, ce qui est absurde, étant donné qu’elle a immédiatement bouleversé mon quotidien. Notre saison de compétition s’est envolée en fumée, les Jeux olympiques ont été reportés et nous avons même été avertis de ne pas pratiquer notre sport en raison des risques de blessures et d’avoir par la suite besoin de soins dans système de santé engorgé. Mais j’ai répondu comme on me l’a enseigné en tant qu’athlète : me concentrer sur les choses que je peux contrôler, me fixer de nouveaux objectifs et adopter une attitude optimiste.
Avec le recul, je réalise mon erreur. Je n’ai pas pris le temps de reconnaître mes émotions. En fait, j’ai complètement refoulé mes sentiments. J’ai plongé tête première dans l’entraînement, mes séances étant plus longues et plus difficiles que jamais auparavant. J’ai commencé une descente insidieuse vers de vieilles habitudes et des schémas de pensée caractéristiques de mon trouble de l’alimentation. J’ai développé de l’insomnie, une restriction alimentaire importante, un tic anxieux dans ma jambe, des battements cardiaques anormalement élevés au repos et, éventuellement, un profond sentiment d’apathie envers tout.
À la fin août, il était clair que la saison de la Coupe du monde en Europe allait être abrégée. Si j’avais été plus consciente, j’aurais réalisé que je n’allais vraiment pas bien. J’étais sous-alimentée, insensible à l’émotion et complètement épuisée. Inutile de dire que ces courses ne se sont pas bien déroulées. Mais elles m’ont fait prendre conscience de l’état de crise extrême dans lequel je me trouvais. J’ai quitté l’Europe – après les pires performances de ma carrière sportive – pour rentrer chez moi, paralysée par la peur de ne jamais pouvoir sortir du trou dans lequel j’étais tombée.
Aujourd’hui, quelques mois après cette période très sombre et grâce à une clarté mentale et une conscience accrues alors que nous faisons face à une autre vague de COVID-19, je me sens mieux préparée à prendre soin de ma santé mentale de manière adéquate.
Grâce à des gestes tels que rencontrer un psychiatre, m’ouvrir à mon entraîneur et à mon mari, planifier des appels Zoom hebdomadaires avec ma famille et réintégrer mes passe-temps dans ma routine quotidienne, j’ai graduellement retrouvé un lieu d’équilibre. De plus, je comprends mieux les pièges spécifiques que la pandémie comporte pour moi.
Avec le recul, il semble évident que la pandémie allait déclencher en moi des réponses inadaptées; une grande partie de mon désordre initial, il y a de nombreuses années, reposait sur le besoin de contrôle face à l’incertitude existentielle. Et qu’est-ce qui pourrait nous rappeler davantage la fragilité et l’instabilité de la vie qu’une pandémie mondiale?
À l’avenir, je sais que je dois faire les choses différemment. Je dois prendre davantage soin de moi. Je dois reconnaître et accepter mes émotions, leur laissant ainsi l’espace pour s’exprimer. Je dois être prête à vraiment abandonner mon emprise sur les choses que je ne peux pas contrôler. Je dois avoir le courage d’admettre quand je ne vais pas bien, car je sais qu’il y aura d’autres creux avant que la vie ne redevienne « normale ». Et par-dessus tout, je dois être honnête envers moi-même à propos de mon état d’esprit et de ce que je vis.
J’ai réalisé pendant cette pandémie que ma relation avec la maladie mentale était toujours active; elle n’est pas dans le passé comme je l’avais pensé auparavant. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas atteindre mes objectifs. Les Jeux olympiques sont toujours mon but et je crois que je peux être la meilleure version de moi-même à Tokyo. Et la façon dont je vais le faire est d’accepter mes batailles internes comme faisant partie de ma personne entière et authentique.
Haley Smith est membre de l’équipe nationale de vélo de montagne depuis 2011. Elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2018 et a obtenu son premier podium en Coupe du monde en mai 2019. Elle espère faire ses débuts olympiques à Tokyo 2020.














